
14 Juin, 2023
Erick Noël
La présence noire à l’échelle de l’Europe du 18e siècle n’est pas insignifiante, et oscille selon les statistiques entre 4 000 à 5 000 individus en France et 15 000 en Angleterre dans le dernier quart du siècle. Cette présence pose d’abord la question de la couleur dite « noire » qui, pour désigner d’emblée une population de souche africaine, issue de la traite et amenée par la voie atlantique ou via la Méditerranée, suggère aussi des Afro-descendants, «nègres créoles» ou métis. L’historien Pierre H. Boulle parlait même de «non-Blancs» dans une formule enveloppante, parfois critiquée car négative dans son approche.
En France, la Police des « Noirs, mulâtres et autres gens de couleur », en tant qu’institution créée pour les surveiller, voire les expulser vers les Antilles, offre à elle seule une entrée. Elle indique, dans son nom, au-delà des Noirs d’Afrique ou des Îles, toute personne née d’un parent blanc et d’un parent noir, sans toutefois dire quels ont été ces « autres » aux contours indécis. Les enregistrements, opérés en 1777-1778 à l’échelle du royaume, livrent les premiers chiffres, permettant de voir qu’on y inclut les « quarterons » (personne ayant un quart de sang « noir ») ainsi que les Indiens d’Asie. Sur cette base, 4 000 à 5 000 personnes auraient alors vécu dans le royaume. Mais si l’on mesure les entrées et les sorties continues de ces hommes et de ces femmes à l’échelle du siècle, c’est à près de 20 000 que l’on peut estimer ceux qui sont passés en France. Les ports de traite raflent la part essentielle, avec près de 6 000 passages à Nantes et plus de 5 000 à Bordeaux, pour faire de Paris un point de fixation qui aurait retenu les trois quarts et demi des Noirs de France à la veille de la Révolution.
Ainsi, on est loin de l’Angleterre où le chiffre de 15 000 au moment de la guerre d’Amérique (1775-1783) est communément admis. Les évaluations anglaises paraissent certes approximatives en l’absence de contraintes d’enregistrement comparables à celles de la France. Elles se basent essentiellement sur des données de presse, comme celles de la Boston Gazette indiquant 14 000 Noirs lors de l’affaire Somerset en 1772, ou sur les chiffres ultérieurement grossis par les philanthropes, voire les planteurs, dans le sens de leurs intérêts. Il n’en reste pas moins que Londres, avec peut-être 10 000 Noirs, paraît un foyer plus important que Paris où ils oscillent entre 3 500 et 4 375. Les ports de traite, Bristol et surtout Liverpool, jouent à cet égard un rôle porteur, au-delà même de la Révolution.
On est également bien en-deçà du Portugal, où dès 1 500 Lisbonne aurait atteint les 10 000 Noirs. Ce chiffre est essentiellement dû à la précocité du processus colonial qui a permis, entre 1440 et 1760, de faire passer jusqu’à 500 ou 600 000 Africains dans le pays. Là encore, la base doit être regardée de près, dès lors qu’elle inclut Maghrébins et Subsahariens. L’implication des pays et des ports occidentaux dans la traite paraît ainsi tirer, sur la façade atlantique, les chiffres par le haut.

Qu’en est-il de la situation de ces hommes et de ces femmes, dans un cadre juridique incertain ? Sont-ils vraiment libres, malgré le privilège dit « affranchissant de la terre de France » mis en avant dès 1571 par le parlement de Bordeaux, ou des adages tels que « as soon as a negro comes in England he becomes free », admis en 1691 en Angleterre ?
En France, des procès retentissants disent toute l’incertitude de leur sort. L’affaire de Francisque, Indien de Pondichéry, physiquement différent des Africains et reconnu libre parce qu’il n’avait pas été formellement déclaré par son maître, ouvre la voie en 1762 à de multiples procès ordinairement tranchés en faveur des plaignants. Cette affaire, qui pénalise les propriétaires doublement – perte de leurs esclaves mais aussi paiement de dommages -, remet en cause durablement la législation. Ainsi, le gouvernement, notamment en la personne du Ministre Choiseul, revoit tout le dispositif et adopte la Loi de Police de 1777. Radicale, cette dernière bloque les procédures en cours et tente de renvoyer indistinctement esclaves et gens de couleur libres au Cap-Français à Saint-Domingue, même s’ils viennent des Indes orientales.
Les archives de l’amirauté de France et des tribunaux de 1777 à 1791 révèlent les parcours très sinueux, et les pérégrinations forcées de « nègres domestiques » ou d’« apprentis » derrière des maîtres venus parfois de l’étranger et simplement de passage dans le royaume. D’ailleurs, la loi de Police interdit à tous les sujets du roi venus des colonies, et « même à tous étrangers », d’introduire des « Noirs, mulâtres et autres gens de couleur » en France, sous peine d’une amende de 3 000 livres. Au-delà des dérogations (domestiques admis à servir leurs maîtres des îles au port d’arrivée) et du flou concernant celles et ceux de passage ou nés en métropole (invités à se déclarer pour être régularisés ou non), l’article 1er révèle des arrivées toujours plus incontrôlées. L’édit du roi de 1716, complété en 1738, ne prend pas en compte cette dimension nouvelle des entrées. La situation s’accentue donc, avec un nombre d’arrivées inédit, en raison de l’internationalisation des conflits, du recul des guerres de Succession d’Autriche (1740-1748) et de Sept Ans (1756-1763), et des effets collatéraux de la guerre d’Amérique.
On remarque en effet la déclaration de nouveaux-venus des pays européens voisins. Le parcours de Francisque et de son frère André est significatif. Débarqués avant 1758 des Indes orientales à Lisbonne, ils y reçoivent le baptême. Ils arrivent ensuite à Paris via Saint-Malo derrière un colon du nom de Brignon. Lors de leur passage à Paris, ils sont maltraités au point d’être entendus par l’amirauté qui astreint leur maître à régler 800 livres à titre de gages impayés. Une douzaine de cas de Noirs ou de mulâtres arrivés du Portugal sont ainsi relevés à partir de 1747 à Paris. La guerre de Succession d’Autriche, dans ses prolongements coloniaux, est clairement le déclencheur du phénomène, comme l’indique le cas de Saint-Louis, « nègre » de Mme Mahé de La Bourdonnais. Ce dernier se retrouve dans la capitale par la voie portugaise en 1748. Déclaré en 1777, il décède chez sa maîtresse en 1784 à Boissy-Saint-Léger, près de Paris. Le tremblement de terre de Lisbonne de 1755 occasionne aussi des déplacements. C’est le cas de Marie-Josèphe Pedro, qui a suivi la dame Jarry après le séisme où elle a perdu toute sa famille. Mariée à un homme blanc du nom de Dieult, elle entre comme cuisinière au service de M. Rose, directeur des domaines, retiré à Paris. Le passage des Pyrénées est aussi rapporté, dès 1762 quand les entrées par voie de mer ont été contrariées par le blocus anglais.

La guerre d’Amérique, surtout, révèle l’ampleur des passages transfrontaliers. Les « observations » du ministère de la Marine du 8 mars 1782 soulignent le nombre des « Noirs introduits en fraude par l’Espagne ou par la Hollande » ; une fraude « qu’on n’avait point prévue » et à laquelle la déclaration de 1777 n’avait « point pourvu ». À cet égard, il convient de noter que l’article 1 de la loi de Police soumet les propriétaires étrangers aux mêmes obligations que les colons français à leur arrivée dans le royaume sans envisager spécifiquement ces passages par voie de terre et notamment par les cols des Pyrénées. Les articles 3 et 4 spécifient des « reconduites » dans les ports et la création de dépôts, au nombre de huit en 1778, tous sur la façade atlantique à l’exception de Marseille. Les entrées de la fin du siècle révèlent des cas venus d’outre-Manche et, nouveauté, des jeunes États-Unis.
Ces entrées « anglo-saxonnes » sont en premier lieu des prises de guerre, selon une tradition ancienne. Par exemple, dès 1693, à l’occasion de la guerre de la Ligue d’Augsbourg et de l’assaut du navire anglais Le Marchand de la Chine par la frégate La Ville de Saint-Malo, un esclave de Guinée est pris et ramené pour être baptisé au Havre sous le nom de Louis Nicolas. La guerre d’Amérique a amené un contingent de Noirs issus des 13 colonies, qu’il reste à mesurer. Parmi eux, se trouvent James et Sally Hemings, frère et sœur, qui ont suivi Jefferson à Paris comme esclaves, mais ne paraissent pas avoir été déclarés en dépit de la nouvelle loi.
La fin de l’Ancien Régime se caractérise par une montée en puissance des libres qui, malgré l’obstacle de la loi de 1777, voyagent de part et d’autre de la Manche comme à travers l’Atlantique. Il y a d’abord les figures d’exception, protégées par un parent blanc : le chevalier de Saint-Georges, fils du planteur Bologne enregistré à son arrivée de la Guadeloupe à Bordeaux avec sa mère en 1749 . Seul à Paris en 1777, il passe librement à Londres où il séjourne en 1784 et croise le fer en 1787 avec le chevalier d’Éon. George Bridgewater, également mulâtre et virtuose du violon, arrive dans l’autre sens (de Londres à Paris) avec son père, originaire de la Jamaïque, pour jouer en 1789 au Panthéon, avant de poursuivre une carrière européenne et de se retrouver en 1803 à Vienne. L’élite des affranchis, lorsqu’elle n’a pas l’appui d’un parent blanc ou d’un bien aux Îles, trouve les moyens de sa liberté dans la haute domesticité. Antoine Malehalé, « nègre » du Mozambique, s’engage dès 1763 par contrat passé devant Me Robineau, notaire à Paris, à servir pour 150 livres de gages le prince de Beloselsky, colonel attaché à Catherine II, et à le suivre en Russie avec la possibilité de rentrer s’il meurt aux frais de ses cohéritiers. Si l’affaire tourne mal et pousse Malehalé à dénoncer le contrat la même année, un autre cas semblable est relevé en 1775 : Yake, dit Lamour, esclave du Surinam assigne son maître le prince de Belochsky pour recouvrer sa liberté et des gages à hauteur de 120 livres par année de service. Dans l’autre sens, la « mulâtresse » Anne de Bour, libre et baptisée à Bonn [?] arrive du Danemark à Paris où elle est attachée en 1777 au sieur Douy vivant quartier de la Madeleine. Dans tous les cas il s’agit d’individus isolés, qui paraissent avoir servi des maîtres fortunés.
La Révolution française a-t-elle accru ces mouvements ? L’émigration de l’élite blanche a pu entraîner derrière elle des domestiques de couleur. Ziméo, « négrillon » du Sénégal, que le chevalier de Boufflers, gouverneur, fait passer en 1786 à Paris pour servir Mme de Blot, est placé en 1789 par la comtesse de Sabran chez un prince de la maison de Prusse. Ces cas semblent pourtant limités et les privilégiés laissent derrière eux la plupart de leurs esclaves et domestiques. A partir de 1792, les hommes de couleur sont plutôt à rechercher dans les enrôlements et les mouvements de troupes créées, à l’instar de la « Légion noire », pour défendre les frontières de la République française, et appelés à intervenir dans l’Empire et en Italie. Dumas, promu général de brigade, se retrouve ainsi en 1794 à la tête de l’armée des Alpes et en 1796 dans le Tyrol, avant d’être sollicité par Bonaparte en 1798 en Égypte. Joseph Domingue est amené sur les mêmes fronts, mais est rétrogradé, en 1801, sur refus de suivre le Général Leclerc au Cap-Français. Ainsi, si les hommes de couleur se font rares dans les commandements, les contrôles de troupes offrent une piste à creuser, comme le démontrent les états de service de ceux qui ont notamment intégré le corps des Pionniers Noirs, devenu Royal-Africain, de Mantoue à Naples et en Russie.
À propos de l’auteur
Erick Noël, agrégé et docteur en histoire, est professeur des universités et enseigne l’histoire moderne à l’université des Antilles, pôle Martinique. Auteur d’une thèse sur les Beauharnais, une fortune antillaise (1756-1796), il a soutenu une HDR sous le titre « Être Noir en France au XVIIIe siècle ». Directeur, aux côtés de 35 enseignants-chercheurs (2011-2017), du Dictionnaire des gens de couleur dans la France moderne (3 vol.,), il a publié récemment Le Goût des Iles sur les tables des Lumières (Puna, 2020) et La Sculpture du Noir au temps de la traite (Hémisphères, 2023).
Bibliographie
Antonio de Almeida Mendes, «Esclavage et race au Portugal : une expérience de longue durée», dans Myriam Cottias et Hébé Mattos (dir.), Esclavage et subjectivités dans l’Atlantique luso-brésilien et français (XVIIe-XXe siècle), Marseille, OpenEdition Press, 2016.
Stephen J. Braidwood, Poor Black and White Philanthropists, Liverpool, Liverpool University Press, 1994, 324 p.
Peter Fryer, Staying Power: The History of Black People in Britain, Londres, Pluto Press, 2018 [1984], 656 p.
Erick Noël (dir.), Dictionnaire des gens de couleur dans la France moderne, Genève, Droz, coll. «Bibliothèque des Lumières», 3 t., «Paris et son bassin», «Le Bretagne», «Le Midi», 2011-2017.
Sue Peabody, ʺThere Are No Slaves in Franceʺ. The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime, New York, Oxford University Press, 1996, 220 p.
All rights reserved | Privacy policy | Contact: comms[at]projectmanifest.eu
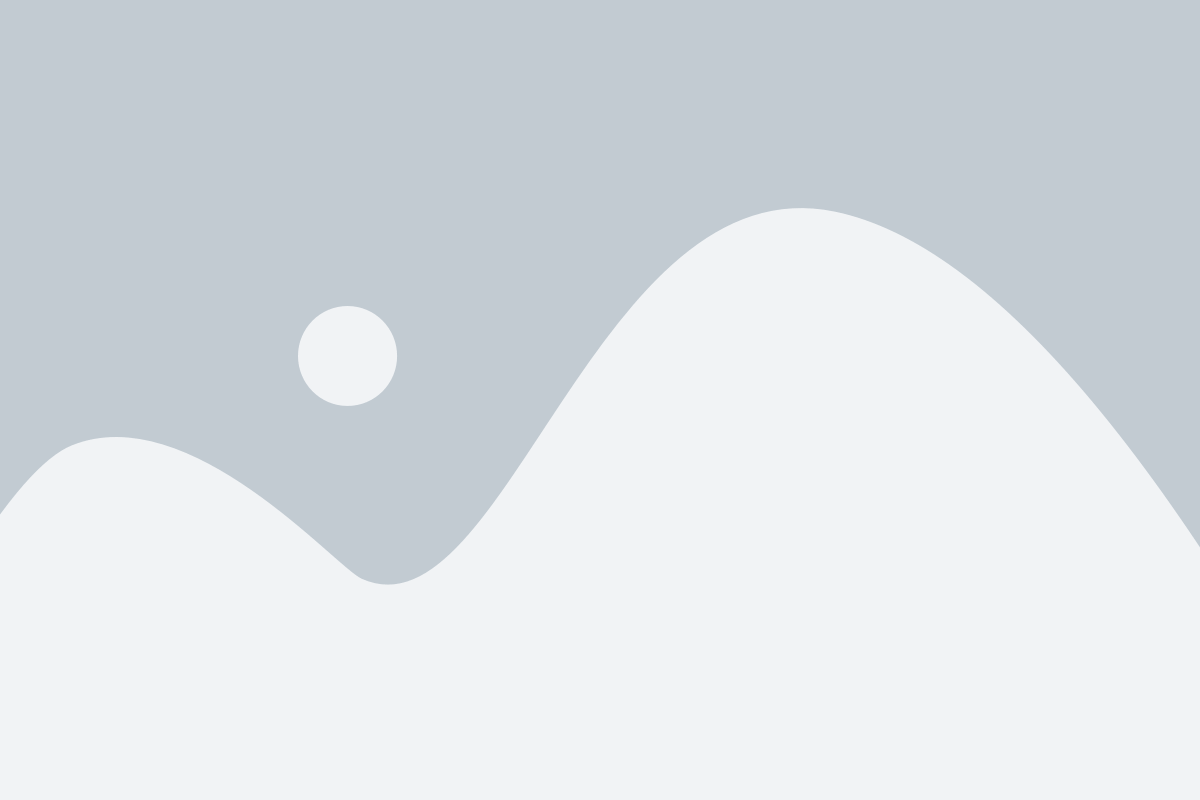
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.