
April 26, 2023
Rafaël Thiebaut
Avec plus de 550 000 captifs africains embarqués entre 1596 et 1829, la traite néerlandaise représente 5% de l’ensemble de la traite transatlantique. De ce fait, les Néerlandais ont été des commerçants moins en vue que ceux d’autres nations européennes tels que les Britanniques, les Français et les puissances ibériques. Néanmoins, ils ont joué un rôle important dans la mise en place de la traite à des moments clés, en dominant le commerce pendant de courtes périodes au 17e siècle, domination suivie d’un déclin rapide au cours du dernier quart du 18e siècle. Leurs activités sont étroitement liées à la forteresse ghanéenne d’Elmina, au Brésil hollandais et aux anciennes colonies du Suriname et des Antilles néerlandaises.
La République néerlandaise protestante s’est formée en 1568 pendant la Réforme et s’est libérée de l’empire catholique des Habsbourg au cours d’une guerre qui a duré quatre-vingts ans, jusqu’en 1648. Grâce à l’afflux de capitaux et de contacts commerciaux en provenance du sud des Pays-Bas, les Provinces-Unies deviennent la plus importante nation commerçante d’Europe. Elles entrent en conflit avec les puissances coloniales ibériques, qui contrôlent la majeure partie du Nouveau et de l’Ancien Monde. À la recherche d’épices, la nouvelle Compagnie des Indes Orientales (Verenigde Oostindische Compagnie – VOC) réussit à conquérir de nombreuses places fortes portugaises dans l’océan Indien. Dans l’Atlantique, les Néerlandais se consacrent principalement à des opérations corsaires visant la capture de riches navires espagnols. Parallèlement, ils s’occupent du commerce du sel, de l’or, de l’ivoire, du bois du Brésil et du tabac. Pour protéger leur commerce, ils ont créé de petites places fortes dans tout l’Atlantique.
Toutes ces initiatives sont privées. Mais les violentes confrontations avec leurs ennemis jurés, l’Espagne et le Portugal, font naître l’idée d’unir leurs forces au sein d’une même compagnie, comme la VOC. Ce qui s’est concrétisé par la poursuite de la guerre avec les puissances ibériques après la fin de la Trêve de Douze Ans (1609-1621). La Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, la WIC, est née en 1624. Elle détiendra le monopole du commerce dans le monde atlantique. Les vingt premières années d’activité sont couronnées de succès. En 1630, les Néerlandais parviennent à s’emparer de la partie nord du Brésil, des prospères plantations sucrières de Bahia et de Recife, qui emploient massivement de la main-d’œuvre servile.
Cette conquête ramène au premier plan le débat sur l’esclavage et la traite esclavagiste. Les Néerlandais doivent-ils suivre l’exemple ibérique ? Les débats religieux sont nombreux et, bien que la Bible affirme que tous les hommes sont égaux, certains membres du clergé considèrent les Africains comme des païens, des enfants de Cham, condamnés à travailler en esclavage pour toujours. Ils peuvent donc être vendus et employés par des propriétaires chrétiens. Le célèbre juriste Hugo de Groot le confirme et justifie le commerce des personnes mises en esclavage en déclarant que les captifs proposés aux Néerlandais sont les victimes de “guerres justes” et qu’ils peuvent légalement être achetés.
En réalité, au Brésil, la très lucrative culture du sucre ne peut se développer que grâce à la traite esclavagiste. Pour ce faire, la WIC doit avoir accès au marché africain. Après quelques succès et échecs mineurs, ils réussissent à s’emparer de toutes les possessions portugaises en Afrique, y compris la forteresse impénétrable d’Elmina au Ghana en 1637 et Luanda en Angola en 1641. Cela favorise l’essor d’un vaste commerce : jusqu’en 1645, quelque 25 000 captifs africains sont vendus au Brésil. Le commerce du sucre génère d’énormes profits, si bien qu’au lieu de sécuriser la campagne brésilienne en proie à la rébellion, la WIC préfère se concentrer sur le commerce. C’est ainsi que le Brésil perd en 1654, tandis qu’Elmina reste néerlandaise. Mais vers quelles destinations peut-on alors emmener ces personnes mises en esclavage ?
Au cours de leur expansion dans les années 1630, les Néerlandais reprennent également plusieurs îles des Caraïbes aux Espagnols, comme Curaçao, Bonaire, Aruba et Saint-Eustache, mais aucune n’est adaptée à la culture du sucre. Ainsi, après la paix de Munster de 1648, les commerçants néerlandais deviennent les intermédiaires des planteurs français et anglais qui se tournent vers les plantations sucrières intensives en main-d’œuvre dans leurs îles des Caraïbes. La main-d’œuvre européenne s’avérant insuffisante, les Néerlandais ont donc volontiers importé des Africains mis en esclavage dans ces îles après la perte du Brésil. Les Néerlandais acheminent également leurs captifs africains vers les Amériques espagnoles, qui ont besoin de milliers de personnes mises en esclavage.
Pour cela, la WIC obtient indirectement “l’asiento de negros”, le droit d’importer des milliers de personnes mises en esclavage dans les possessions espagnoles d’Amérique à des périodes déterminées, par exemple de 1662 à 1675. Curaçao, stratégiquement située près de la côte vénézuélienne, devient une importante plaque tournante esclavagiste régionale, livrant quelque 100 000 personnes aux Espagnols, principalement pendant l’asiento, mais aussi illégalement après 1675. Au cours de cette période, la WIC est la société commerciale la plus puissante et la plus importante compagnie de traite, avec plus de 50 000 personnes négociées.
Par ailleurs, les Néerlandais s’établissent également dans des colonies aux plantations plus prometteuses le long de la côte guyanaise, à Essequibo et Berbice dans la première moitié du 17e siècle et reprenant le Suriname aux Anglais en 1667. En 1685, le Suriname devient une société privée réunissant la WIC, Amsterdam et l’investisseur privé Sommelsdijck. Mais la main-d’œuvre esclave est toujours insuffisante et trop coûteuse. La moitié des captifs africains est acheminée vers les Antilles néerlandaises avant 1675, contre seulement 13 % par la suite.
Mais entre-temps, la WIC souffre financièrement de la très coûteuse guerre du Brésil et perd l’essentiel de ses revenus avec la perte de cette colonie. La compagnie n’est plus rentable et est dissoute en 1674 avant d’être immédiatement rétablie dans une version plus légère, bien qu’identique. Le monopole de la traite esclavagiste constitue son principal centre d’intérêt. Il s’organise autour des derniers forts commerciaux de la Côte d’Or (actuel Ghana), les possessions néerlandaises en Angola ayant été perdues au profit des Portugais.
Les Néerlandais disposent à nouveau de l’asiento entre 1686 et 1689. Mais, en raison des guerres qui ont suivi et des pertes liées aux expéditions corsaires françaises, les Néerlandais perdent progressivement le contrôle du commerce des esclaves au profit des Anglais, qui obtiennent l’asiento en 1715. La nouvelle WIC ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour rivaliser avec les autres nations européennes dans la traite transatlantique et lutte difficilement contre les contrebandiers hollandais. La situation financière de la WIC devient critique et, en 1738, elle décide de renoncer à son monopole sur la traite en Afrique de l’Ouest.
Entre 1624 et 1738, la WIC vend près de 140 000 captifs, en majorité à des colonies néerlandaises, tandis que les trafiquants de contrebande vendent 40 000 captifs. Les personnes mises en esclavage sont convoyées aux Antilles principalement entre 1650 et 1725. Avant 1675, environ 1 500 captifs sont déportés par an, puis 1 000 jusqu’en 1730 et enfin 500 par an. Les années 1734-1774 marquent l’apogée de la traite esclavagiste néerlandaise avec 140 000 personnes négociées et envoyées en Guyane néerlandaise, 10 000 aux Antilles néerlandaises et 10 000 dans les colonies étrangères. Cette période a favorisé la croissance de grandes entreprises privées telles que la Middelburgse Commercie Compagnie, qui a géré environ 20 % de l’ensemble de la traite néerlandaise. Cela a été possible en raison d’une demande et d’une offre croissantes, au moment où les négociants néerlandais explorent de nouvelles régions pourvoyeuses en Afrique, telles que la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone.
Le Suriname est la colonie la plus importante avec 200 000 captifs africains importés, tandis que les trois autres régions guyanaises en comptent 42 000 au total. La traite esclavagiste connaît un essor mondial considérable après 1750, et les négociants privés hollandais suivent le mouvement. Cependant, dans les années 1770, les planteurs du Suriname sont incapables de rembourser les crédits qu’ils ont contractés pour acheter des captifs. Il est alors décidé que ceux-ci ne peuvent plus être vendus à crédit. Cette décision provoque une crise de la traite néerlandaise, qui se délite, passant de 3 600 à 1 400 personnes par an sur trois à quatre navires. La quatrième guerre anglo-néerlandaise (1780-1784) frappe encore plus durement ce commerce, faisant chuter le nombre de captifs néerlandais à 100 par an.
En 1800, le Suriname est une économie de plantation. Basée sur les cultures d’exportation comme le sucre, elle compte 40 000 personnes en esclavage, principalement employées dans les plantations, et 4 000 Européens et hommes libres. Curaçao et Saint-Eustache jouent un rôle important dans le commerce de transit. La majorité des personnes mises en esclavage gagnent de l’argent grâce à leur talent et à l’artisanat, et seul un quart d’entre elles sont des “esclaves des champs”. Curaçao compte 8 000 libres et Européens et 13 000 personnes en esclavage. Une importante révolte d’esclaves a pourtant eu lieu sur l’île en 1795. Les autres îles néerlandaises des Caraïbes ne comptent alors que quelques milliers de personnes en esclavage.

Les Néerlandais ont mené plus de 1 200 expéditions, ce qui représente une moyenne d’environ 350 captifs africains déportés par navire. Le tonnage des navires a également diminué, passant de 500 captifs avec la WIC à moins de 300 par la suite. Le Passage du milieu est organisé comme n’importe quelle autre expédition maritime, avec les mêmes marins, mais avec des risques plus élevés en raison des révoltes et des maladies africaines. Au départ de l’Europe, la cargaison est composée principalement de textiles indiens, de matériel militaire et d’alcool. Le navire rejoint une place forte néerlandaise sur la Côte d’Or. Cependant, surtout au 18e siècle, les Néerlandais ne parviennent pas à fournir suffisamment de captifs pour tous les navires ; ainsi près de trois quarts de la flotte néerlandaise est obligée d’aller commercer directement avec d’autres Africains le long de la côte.
La plupart des captifs échangés, environ trois cinquièmes, sont des hommes et un cinquième des enfants, comme habituellement dans la traite transatlantique. Au fil du temps, le pourcentage de femmes augmente et le nombre d’enfants double même. Les Néerlandais perdent environ 2 captifs sur 1 000 par jour, soit plus que sur les navires français et anglais, ce qui peut s’expliquer par les conditions physiques des captifs africains dans les régions où les Néerlandais les achètent. La mortalité moyenne est de 12,6 % pendant les 2 mois et demi du passage du milieu, mais elle diminue au cours du 18e siècle de 3 points de pourcentage pour atteindre 11,4 %. Le nombre de révoltes est élevé :un cinquième des navires est confronté à des captifs africains rebelles.
Les profits de la traite esclavagiste sont sujets à discussion. La deuxième WIC n’a jamais réalisé de bénéfices ; elle a uniquement enregistré des pertes, de l’ordre de 4 millions de florins [environ 42 millions d’euros] à la fin du 18e siècle. Les expéditions individuelles n’enregistrent que 2 à 3 % de bénéfices, mais ce chiffre fluctue : certains voyages affichent jusqu’à 80 % de bénéfices, tandis que d’autres se soldent par des pertes nettes. L’un des principaux problèmes est la vente d’esclaves à crédit aux planteurs. Cette situation est renforcée par la crise du Suriname en 1774. Sur cette base, certains historiens affirment que, la traite esclavagiste ne représente que 1 %, voire moins, de l’ensemble du commerce maritime hollandais. Mais il faut tenir compte de l’ensemble du système qui utilise des personnes mises en esclavage. Ainsi, si l’on inclut les plantations de cultures marchandes, les assurances, les raffineries, etc., cette économie représente quelque 5,2 % du produit intérieur brut néerlandais en 1770.
À propos de l’auteur
Rafaël Thiebaut a soutenu sa thèse de doctorat sur les traites néerlandaises et françaises à Madagascar en 2017. Cette recherche a reçu trois Prix de thèse, dont le Prix de thèse de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. Post-doctorant à l’Institut International d’Histoire Sociale d’Amsterdam, il a ensuite fait partie du projet “Resilient Diversity : the Governance of Racial and Religious Plurality in the Dutch Empire 1600-1800”. Il a également donné des cours dans plusieurs universités françaises. Plus récemment, Rafaël a intégré un nouveau poste post-doctoral au Musée du quai Branly – Jacques Chirac où il étudie le lien entre les objets du musée et l’esclavage.
Bibliographie
P.C. Emmer, 2020, Geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel, Amsterdam, Nieuw Amsterdam.
H. Den Heijer, 1994, De geschiedenis van de WIC, Zutphen, Walburg.
D, Eltis & D. Richardson, 2010, Atlas of the Transatlantic Slave Trade,, New Haven, Yale University Press.
K. Fatah-Black, 2018, Sociëteit van Suriname – 1683 – 1795: het bestuur van de kolonie in de achttiende eeuw, Zutphen, Walburg.
R. Paesie, 2014, Geschiedenis van de MCC : opkomst, bloei en ondergang,
All rights reserved | Privacy policy | Contact: comms[at]projectmanifest.eu
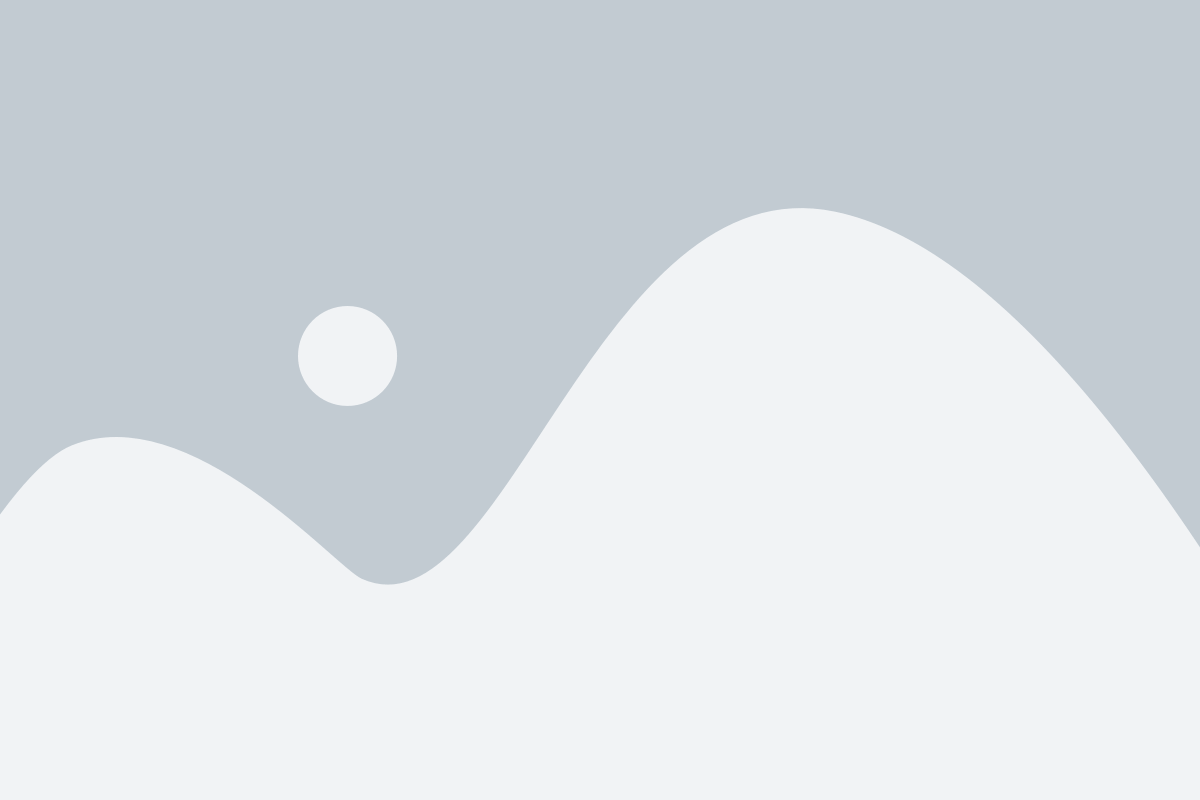
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.