
9 Juin, 2023
Emmanuel Parent
La chanteuse Beyoncé est une icône internationale, dont le travail mémoriel circule à travers les trois continents de la traite transatlantique. Dans les années 2010, elle parvient à problématiser la question de la mémoire sociale de l’esclavage états-unien dans le contexte d’une culture pop globalisée et capitaliste. Déjà dans son clip « Apeshit », elle propose une relecture postcoloniale de certaines œuvres emblématiques du Musée du Louvre de Paris ou du film « Black is King » en partie tourné au Nigeria et au Ghana. Avec son morceau « Formation », issu de l’album Lemonade (2016), elle s’emploie à faire fructifier l’héritage culturel de la Louisiane coloniale avec son histoire personnelle, quitte à faire ressurgir certains spectres oubliés de la question raciale et intersectionnelle aux États-Unis.
En février 2016, la chanteuse Beyoncé Carter-Knowles est à l’affiche de la mi-temps du Superbowl, l’événement télévisé le plus regardé de l’année aux États-Unis. Accompagnée par une équipe de danseuses dont les tenues et la chorégraphie évoquent les milices des Black Panthers et la figure de Malcolm X, elle y présente son dernier morceau, « Formation », ode à l’empowerement féministe, individuel et collectif. Naguère icône consensuelle de la musique pop avec son groupe Destiny’s Child, Beyoncé stupéfie l’Amérique en revendiquant une filiation avec le radicalisme politique noir des années 1960. Le clip de la chanson rendu public quelques jours plus tard va densifier encore un peu plus le message de la star.
Tourné dans la ville de La Nouvelle-Orléans, sur fond d’images des destructions de l’ouragan Katrina, mais également des traditions créoles locales comme les parades Second Lines et des Mardi Gras Indians, ce clip fait résonner le discours militant de Beyoncé avec les catastrophes qui affectent la vie des communautés africaines-américaines aux États-Unis, et leur capacité de résilience.

À la façon d’un morceau de blues où les difficultés sociales sont généralement saisies à partir d’un récit autobiographique, c’est la vie de Beyoncé elle-même qui est présentée comme intimement liée aux aléas de l’histoire des communautés afrodescendantes de Louisiane et du Sud des États-Unis. Face caméra et sur un son rap puissant, la chanteuse débute le morceau par un exercice généalogique dans lequel elle revendique ses origines familiales sudistes, de l’Alabama à la Louisiane, son identité créole et sa fierté noire :
« My daddy Alabama, momma Louisiana,
You mix that Negro with that creole, make a Texas bama
I like my baby heir with baby hair and afros
I like my negro nose with Jackson Five nostrils
Earned all this money, but they never take the country out me
I got hot sauce in my bag, swag »
Les traits phénotypiques (les cheveux, le nez), la sociologie de la migration (l’expression Texas bama, qui désigne généralement une personne originaire du Sud à l’allure paysanne), l’attachement au Sud (the country) et à sa culture sont convoqués ici. La sauce piquante (hot sauce) qu’elle garde dans son sac à main et censée lui apporter la classe (swag) est ainsi un marqueur de la cuisine créole de la Nouvelle-Orléans. Dans une mise en scène étrange où les destructions de Katrina ont laissé place à des images du vieux Sud colonial, ante bellum, c’est finalement la question de la filiation (heir) et, par-là, du passé esclavagiste des sociétés post-coloniales du Nouveau monde, que vient interroger Beyoncé.
« Formation » est le morceau final de l’album Lemonade, à l’échelle duquel se jouent des aller et retours constants entre son histoire individuelle et le destin de sa communauté. Elle y déploie un arc narratif qui va de la trahison à la rédemption et raconte comment elle est parvenue à surmonter les infidélités de son mari, le rappeur Jay Z. Dans les interviews qui ont accompagné la sortie de l’album, Beyoncé a très clairement associé ses difficultés conjugales avec l’histoire de sa famille, dans laquelle se reproduirait à chaque génération des relations difficiles avec les hommes. La généalogie connue de sa lignée maternelle – une famille créole de Louisiane – remonte à la fin du 18e siècle avec l’union entre un marchand blanc et une esclave noire. Cette relation sexuelle socialement asymétrique, que d’aucuns rattachent au viol des esclaves noires par les maîtres blancs, a produit une descendance de femmes métisses susceptibles de participer à la culture du « plaçage ». Dans la société louisianaise et dans les Amériques coloniales en général, les femmes métisses sont considérées comme plus désirables sexuellement et régulièrement « placées » comme amantes ou esclaves sexuelles de riches propriétaires sudistes. C’est notamment le cas de Celestine Lacey, première femme métisse de la lignée née en 1830, qui a eu 13 enfants avec son maître par ailleurs marié à une femme blanche.

Cette distinction raciale, qui valorise les femmes métisses sur un marché sexuel, s’est perpétuée après l’esclavage, en particulier dans le domaine du spectacle où les femmes à la peau claire et aux cheveux lisses sont réputées plus attrayantes que celles à la peau noire. Beyoncé, star du R’n’B, sait qu’elle doit une partie de sa réussite à l’idéal de beauté métisse qu’elle incarne pour la société américaine. Elle hérite donc des problèmes engendrés par le métissage forcé, à la fois malédiction qui se répète de génération en génération, mais également, et paradoxalement, une des raisons de son succès. En cela son histoire reconduit certaines structures de la vie de ses aïeules mises en esclavage. Avec « Formation », Beyoncé propose un récit qui superpose de nombreuses strates où les histoires personnelle, familiale et culturelle se font mutuellement écho. Ici, la musique pop devient le lieu où la mémoire noire de l’esclavage peut se trouver mise en scène, dans toute sa complexité.




À propos de l’auteur
Emmanuel Parent est maître de conférences en musiques actuelles et ethnomusicologie à l’université Rennes 2 en France et chercheur au sein de l’unité de recherche « Arts : pratiques et poétiques ». Ses recherches portent sur la musicologie et l’anthropologie des musiques africaines-américaines, des blues au hip-hop et jusqu’aux musiques électroniques. Il a notamment publié l’ouvrage Jazz power. Anthropologie de la condition noire chez Ralph Ellison (CNRS Editions, 2015) et le catalogue de l’exposition, présentée à la Cité de la musique à Paris, Great Black Music. Les musiques noires dans le monde (Actes Sud, 2014).
Bibliographie
Tanish Ford, « Beysthetics : ‘Formation’ and the politics of style », dans Kinitra D. Brooks & Kameelah L. Martin, eds., The Lemonade Reader, Londres et New York, Routledge, 2019, p. 192-201.
Jean Jamin, « Une société cousue de fil noir. À propos de Faulkner Mississippi d’Édouard Glissant », L’Homme, n° 145, 1998, p. 205-220.
Emmanuel Parent, « Beyoncé, la reine et le vernaculaire », Lili, la rozell et le marimba, n° 2, revue éditée par La Criée, Centre d’art contemporain, Rennes, 2021, p. 54-58.
Tracy Denean Sharpley-Whiting, « “I see the same ho” : les figurantes lascives dans les clips, la culture de la beauté et le tourisme sexuel diasporique » [2007], dans Gérôme Guibert et Guillaume Heuguet (dir.), Penser les musiques populaires, Paris, Éditions de la Philharmonie, 2022, p. 211-230.
All rights reserved | Privacy policy | Contact: comms[at]projectmanifest.eu
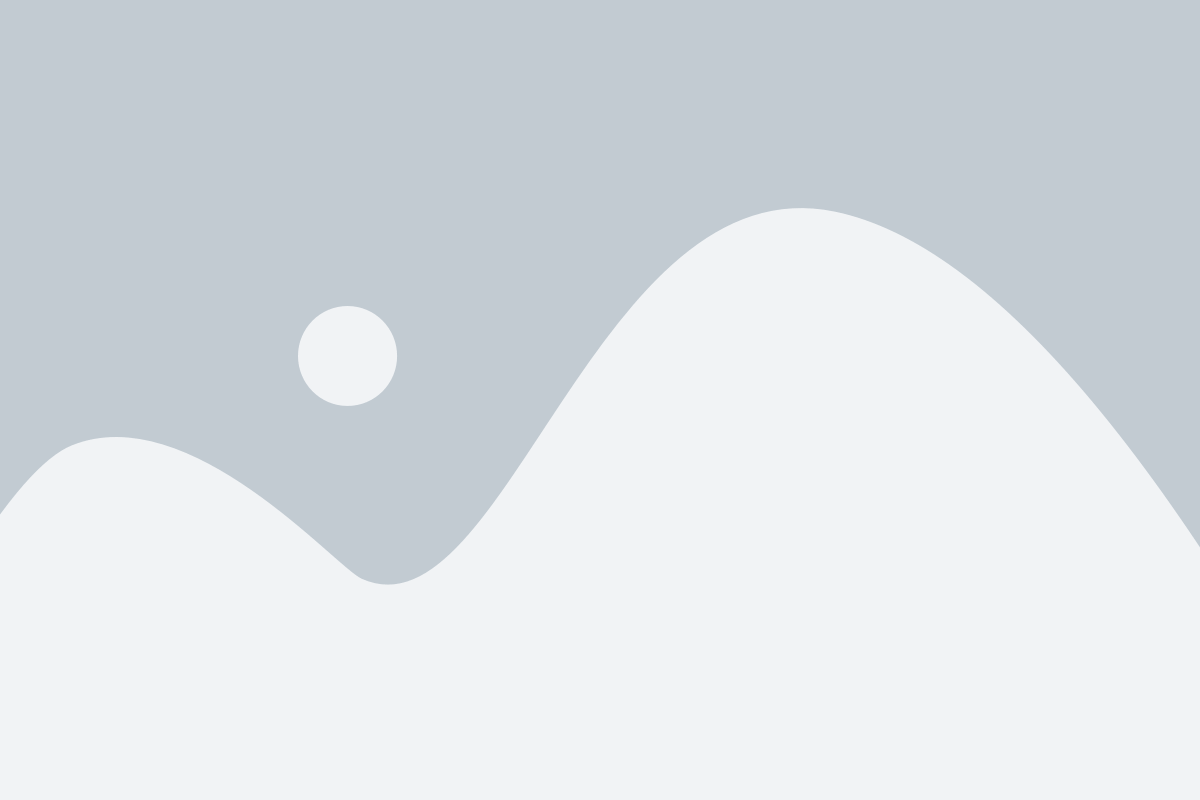
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.