
March 6, 2023
Catherine Coquery-Vidrovitch
La traite atlantique (légale puis clandestine) monte en puissance à la fin du 17e siècle et atteint son maximum entre 1760 et 1830, en Atlantique nord sous la forme de la « traite triangulaire » (port européen, côte africaine, traversée de l’Atlantique et retour vers l’Europe), et en Atlantique sud « en droiture », c’est-à-dire directement entre les côtes congolaises et le Brésil car les vents et les courants y sont plus favorables).
Les circuits sont définis par les Portugais au 16e siècle avec la « découverte » des Caraïbes en 1492 et celle du Brésil en 1500. Ils débarquent à Ceuta au nord du Maroc en 1415 et longent année après année les côtes occidentales d’Afrique jusqu’au Cap de Bonne Espérance, atteint en 1488 et franchi en 1498. Leurs caravelles ont intérêt à être bien accueillies par les peuples riverains. Les nouveaux venus apportent des marchandises alléchantes inconnues jusqu’alors en Afrique : tissus, « pacotilles » diverses (miroirs, couteaux, etc.,) mais aussi « fusils de traite » et alcools. Ils cherchent en échange à obtenir de l’or, dont ils ont appris depuis l’Atlas catalan de 1375 (réalisé par un juif du Majorque instruit par les Arabes de Méditerranée) qu’il arrive non pas d’Afrique du nord, mais par les pistes transsahariennes du sud du Sahara. La première « traite triangulaire » fut donc une traite côtière africaine : installés sur la côte proche du royaume Kongo (Angola intérieur) à partir des années 1480, les Portugais s’y fournissent en esclaves qu’ils utilisent, d’une part, pour répondre à la demande de la côte de l’or (actuelle côte du Ghana) mais aussi pour créer au fond du golfe du Bénin, dans l’île de Saõ Tomè, les premières plantations esclavagistes de canne à sucre (importée de l’Inde et de l’Égypte).
La culture de la canne à sucre exige une très importante main-d’œuvre. Apportés des côtes d’Afrique équatoriale, les esclaves, bien plus nombreux que les planteurs sur l’île, se révoltent dès le milieu du 16e siècle sous la conduite d’un chef dynamique, Amador (dont les écoliers de Saõ Tomè chantent encore aujourd’hui les louanges). Les plantations sont incendiées et l’île mise à feu et à sang. Les planteurs épouvantés démontent leurs moulins à sucre, et les emmènent avec leurs esclaves au Brésil récemment « découvert ». C’est ainsi que commence l’expansion phénoménale des plantations esclavagistes du Brésil, passées au 17e siècle aux Antilles. L’île française de Saint-Domingue devient au siècle suivant la principale productrice de canne, jusqu’à ce que l’insurrection des esclaves de l’île, entamée en 1791, aboutisse en 1804 à la création du premier État indépendant noir hors Afrique, Haïti. Néanmoins, dans les autres Caraïbes, cette culture devenue dominante démultiplie les importations et donc les captures d’esclaves africains.
C’est alors que les relations changent entre Africains et Européens. Elles avaient été cordiales au début entre le roi du Portugal et le roi du Kongo (Angola actuelle). Celui-ci se convertit au christianisme en 1497, espérant capter ce faisant les techniques importées du Portugal (construction, travail du fer, etc.). Mais bientôt la capture des esclaves l’emporte, et le royaume du Kongo décline pour disparaître au 19e siècle. Sur le reste de la côte Atlantique, les chefferies côtières jusqu’alors ouvertes au commerce se transforment en entrepôts d’esclaves fournis par les razzias systématiques qu’elles font pratiquer dans l’arrière-pays. Les Fanti de côte de l’or, jusqu’alors exportateurs d’or, deviennent à leur tour marchands d’esclaves. C’est le cas des autres ports, comme Douala au Cameroun ou Loango sur la rive droite du fleuve Congo. De proche en proche, la traite africaine gangrène les routes et les royaumes intérieurs, y compris au cœur de l’Afrique équatoriale et sur la côte mozambicaine.
Certains petits royaumes sur les côtes et dans l’arrière-pays en tirent avantage. Les souverains ont compris que vendre des esclaves est profitable, contre les marchandises appréciées et les fusils que leur apportent les marchands d’esclaves européens. Ils combinent un système politique et économique adapté aux circonstances : en saison sèche, ils emmènent leurs soldats conquérir ailleurs des esclaves (car on ne vend pas les siens mais des ennemis) qu’ils vendent aux Européens, Britanniques et Français en Afrique de l’ouest, Portugais et Brésiliens en Afrique équatoriale et sur la côte mozambicaine ; en saison humide, les soldats reviennent cultiver aux champs ; au 19e siècle, où les matières premières oléagineuses sont réclamées par les Occidentaux, cette complémentarité accroît leur richesse. Ces royaumes connaissent leur essor à partir de la fin du 17e siècle, et au siècle suivant jusque dans la première moitié du 19e, c’est-à-dire selon une chronologie démarquée de la genèse, de l’essor et du déclin de la traite atlantique. Il s’agit entre autres des royaumes d’Abomey (ou du Dahomey, actuelle Bénin) et, dans l’arrière-pays, de l’empire Ashanti autour de sa capitale Koumassi (Ghana actuel) qui combine la traite vers le sud au commerce des noix de palme vers le sahel, où elles sont très appréciées des musulmans pour leurs qualités euphorisantes. Un peu partout à l’intérieur, la prise d’esclaves se développe en raison de la demande toujours croissante. Un processus analogue se développe (surtout au 19e siècle) sur la côte orientale où le sultan de Zanzibar et les chefs swahili, qui en dépendent plus ou moins, répondent à la demande dans l’océan Indien et au-delà. Les Swahili créent aussi des plantations esclavagistes (sisal, canne à sucre, etc.) tout le long de la côte, approvisionnées par des caravanes qui razzient l’arrière-pays.
La chasse aux esclaves se pratique de différentes manières, soit à l’occasion de guerres internes comme par exemple entre l’État du Bornou (cuvette tchadienne) et ses voisins ; soit par simple brigandage, où des marchands d’esclaves africains s’emparent de gens, femmes et enfants plus ou moins isolés travaillant aux champs, revendus de proche en proche à des caravanes de plus en plus fournies d’esclaves enchaînés. Ils aboutissent en fin de course entassés dans les barracons de la côte où les forts de commerce construits par les Occidentaux, comme les forts portugais, néerlandais et britannique de Cape Coast sur la côte de l’or, ou les forts portugais de Mombasa sur la côte orientale, portugais et français de Ouidah sur la côte du Bénin (actuel) alors dénommée « ». Ils sont entassés en attente des navires de traite qui viennent en prendre livraison. Au début du 19e siècle, les réseaux de traite interne traversent le continent de part en part ; on connaît, entre autres, l’histoire d’une esclave, Bwanika, capturée quelque part aux limites entre la République Démocratique du Congo et la Tanzanie actuelles, revendue une dizaine de fois, échappée à deux reprises de caravanes, l’une l’entrainant vers l’océan Indien, l’autre vers l’Atlantique… Elle finit recueillie dans une mission protestante où elle raconte sa vie.
Le paradoxe est qu’au 19e siècle l’abolition progressive de la traite atlantique par les puissances européennes (de 1807 par la Grande-Bretagne à 1831 pour la France) provoque l’intensification de la traite et de l’esclavage africains. Car les réseaux bien installés à l’intérieur ne trouvent plus preneurs sur l’océan. Des « stocks d’esclaves » invendus s’accumulent, incitant les pouvoirs africains en place à s’adapter. Ils le font de deux façons. La première est leur mise au travail pour la production interne des matières premières réclamées par la genèse de la révolution industrielle occidentale : huiles d’arachides et noix de palme, sisal, etc. : dans le sud du Nigeria actuel, dès le début du 19e siècle, et dans le royaume du Dahomey à partir des années 1830. L’autre issue est d’en faire des soldats pour les conquêtes africaines impériales qui se développent au même moment : jihads (guerres saintes) dans l’ouest africain d’Ousman dan Fodio jusqu’en 1810, de El Hadj Omar un peu plus tard, de Samori ensuite. C’est aussi le cas d’empires esclavagistes non religieux qui prennent forme en Afrique orientale. L’un des plus redoutables est celui de Rabah, ancien esclave originaire du Bahr el Ghazal, formé en Égypte, qui s’avance jusqu’au Bornou à l’ouest du lac Tchad dans la deuxième moitié du 19e siècle, et aussi de Mirambo de Tanzanie et de Msiri du Katanga en Afrique centrale orientale. Ce sont ces empires esclavagistes qui résistent le plus longtemps aux conquêtes coloniales de cette fin de siècle. Leur approvisionnement en fusils de traite est décuplé par le déclin de la traite atlantique. Compte tenu des progrès militaires européens, le matériel obsolète des armées est périodiquement remplacé, et certains centres métallurgiques, comme Liège en Belgique, se spécialisent dans la transformation des fusils en « fusils de traite », moins efficaces. Ils sont écoulés en Méditerranée où l’ouverture du canal de Suez en 1869 facilite leur passage par la mer Rouge. D’où, dans le dernier tiers du siècle, l’essor redoublé du trafic d’esclaves du sultanat de Zanzibar, après que la capitale se soit déplacée d’Oman (en Arabie) à Zanzibar en 1840, compte tenu de l’importance prise par ce port pour la traite dans l’Océan indien. Désormais sultanat indépendant, dominant l’ensemble de la côte orientale africaine, Zanzibar est devenu un pôle majeur du trafic d’esclaves, plus ou moins lié aussi aux activités de contrebande des îles britannique et française (La Réunion et l’île Maurice). Un marchand d’esclaves swahili surnommé Tippu Tip, un moment allié du roi des Belges Léopold II, crée ses plantations sur le haut fleuve Congo et meurt à Zanzibar en 1904 : il a droit à une notice nécrologique dans le Times de Londres.
Le résultat est paradoxal : au fur et à mesure que l’esclavage est aboli aux Amériques au fil du siècle (1835, 1848, 1863, 1880, 1888), il devient de plus en plus massif en Afrique. On Dans la traite de l’océan Indien, on estime que vers 1880, selon les régions, entre un tiers et la moitié des habitants sont de statut servile, ce qui est probablement dix fois plus que quelques siècles auparavant. Plus encore, ce système esclavagiste africain est devenu rentable pour les Européens, désormais gourmands de matières premières tropicales consommées par l’industrie : oléagineux tropicaux, produits de la chasse (ivoire), caoutchouc à partir des années 1880, tous produits par une main-d’œuvre africaine plus ou moins réduite en esclavage, comme le coton du sud des États-Unis l’avait été dans les plantations esclavagistes de la première moitié du 19e siècle. Autrement dit, en Afrique, le mode de production esclavagiste sous contrôle africain continue à approvisionner l’essor du capitalisme occidental. C’est le régime colonial, instauré tardivement, à la toute fin du 19e siècle, qui met progressivement fin aux pratiques serviles « coutumières » (guère avant la Première Guerre mondiale) pour le remplacer par une autre forme de travail contraint, dit « travail forcé ».
🔶 Les routes de l’esclavage, film en 4 épisodes, ARTE, 2018. Accessible en ligne : https://boutique.arte.tv/detail/les_routes_de_l_esclavage
Trailer en anglais : https://vimeo.com/197021455.
À propos de l’auteur
Catherine Coquery-Vidrovitch agrégée d’histoire est spécialisée de l’histoire de l’Afrique subsaharienne. Ses travaux portent sur l’Afrique, les enjeux politiques de la colonisation ainsi que sur le concept d’impérialisme et de capitalisme en Afrique. Sa thèse d’État de 1970 étudie la mise en place d’une économie coloniale par la France en Afrique équatoriale entre 1898 et 1930. Elle s’intéresse également aux femmes dans le contexte colonial, visant à mettre en valeur leur rôle et leur fonction dans la société. Elle a aussi travaillé sur l’histoire de l’urbanisation africaine depuis ses origines.
Bibliographie
Catherine Coquery-Vidrovitch, L’Afrique et les Africains au XIXe siècle. Mutations, révolutions, crises, Paris, Armand Colin, coll. « U », 1999, 304 p.
Catherine Coquery-Vidrovitch, Les routes de l’esclavage : Histoire des traites africaines VIe-XXe siècle, Paris, Albin Michel, 2018, 288 p.
Martin A. Klein, Slavery and Colonial Rule in French West Africa, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, 356 p. ; Esclavage et pouvoir colonial en Afrique occidentale française, trad. Charles Becker et Lysa Hochroth, Paris, Karthala/CIRESC, 2021, 566 p.
Paul Lovejoy, Transformations in Slavery. A History of Slavery in Africa, New York, Cambridge University Press, 2012 [1983], 381 p. ; Une histoire de l’esclavage en Afrique. Mutations et transformations (XIVe–XXe siècles), trad. Sara Dezalay, Salvatore Sagues et Pascale Mc Garry, Paris, Karthala/CIRESC, 2017, 441 p.
Ibrahima Thioub, « Regard critique sur les lectures africaines de l’esclavage et de la traite atlantique », dans Issiaka Mande et Blandine Stefanson (dir.), Les Historiens africains et la mondialisation, Actes du 3e congrès international des historiens africains (Bamako, 10-14 septembre 2001), Paris, Karthala, 2005, p.271-292.
All rights reserved | Privacy policy | Contact: comms[at]projectmanifest.eu
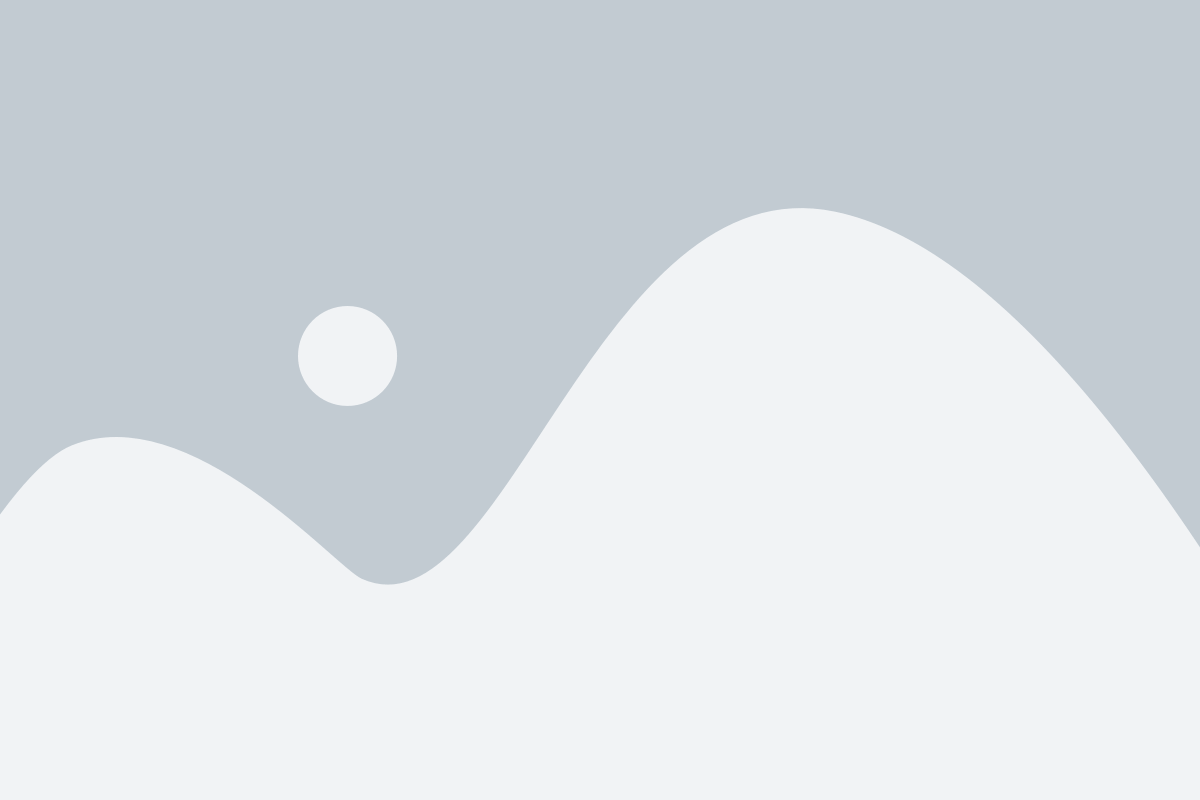
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.