
March 30, 2023
Bernard Gainot
Apparue à Paris en 1788, la Société des Amis des Noirs reprend le modèle de son homologue britannique. Durant la décennie révolutionnaire, elle évolue d’une société de pensées à un club politique qui, paradoxalement, décline après l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises.
La Société pour l’abolition de la traite des nègres, fondée à Paris le 19 février 1788, s’inspire des sociétés anti-esclavagistes, qui se sont développées aux États-Unis après 1783, à l’initiative des Quakers, en Pennsylvanie notamment. Mais le modèle de référence le plus proche est la Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade, fondée à Londres en mai 1787. Les principaux animateurs de la Société française sont le publiciste Jacques-Pierre Brissot et le banquier d’origine genevoise Étienne Clavière. Tous deux ont fait des séjours prolongés dans les pays anglo-saxons et sont de fervents admirateurs de la jeune république états-unienne. Dans le proche entourage de Mirabeau, écrivain et homme politique réformateur français, ils rédigent l’Analyse des papiers anglais. Ces derniers ont pour ambition de servir de trait d’union aux partisans du constitutionalisme (qui donne primauté à la loi), sur les deux rives de la Manche, et aussi de coordonner les efforts avec les anti-esclavagistes anglais (dont les figures majeures sont Thomas Clarkson, Granville Sharp et William Wilberforce). L’objectif est d’obtenir par la loi l’abolition immédiate de la traite puis, à terme, l’extinction de l’esclavage, tout en préservant le système économique de la plantation coloniale.
Le trio originel est bientôt rejoint par l’encyclopédiste Nicolas de Condorcet, qui avait publié sous pseudonyme en 1781 un vigoureux pamphlet contre la traite. Ultérieurement, le groupe dirigeant s’étoffe de l’abbé Henri Grégoire, du pasteur Benjamin-Sigismond Frossart, du docteur François-Xavier Lanthenas. De nombreuses personnalités politiques, qui jouent un rôle majeur au début de la Révolution française, assurent aussi le rayonnement de la Société : outre Mirabeau, le marquis de La Fayette ou le duc de La Rochefoucauld d’Enville. Le registre de la Société pour l’abolition de la traite des nègres révèle un rythme régulier et soutenu des séances, de l’ordre de trois par mois avec une participation moyenne de douze sociétaires.
La Société s’apparente à une société de pensée (statuts, règlements, cooptation des membres), mais aussi à un groupe de pression (lobby) tourné vers les centres de décision : d’abord le secrétariat d’État à la Marine et aux colonies, puis, à partir de juillet 1789, l’Assemblée nationale Constituante. Elle vise à obtenir une législation qui interdirait la traite, en concertation avec les autres puissances coloniales (essentiellement l’Angleterre, secondairement les Provinces-Unies – actuels Pays-Bas – et le Portugal). Le tarissement de la source d’approvisionnement en main-d’œuvre servile doit conduire à une amélioration du sort des esclaves sur les plantations, puis à l’augmentation du volume des affranchissements. À terme, l’esclavage s’éteindrait, sans rupture majeure de la structure économique.
À la différence de son homologue britannique, la Société française n’organise pas des campagnes de pétitions de masse pour gagner l’opinion publique. Elle cherche avant tout à obtenir des textes de lois susceptibles de faire avancer le programme. Elle publie des brochures, cherche à gagner des personnes influentes au ministère, prépare surtout des discours pour arracher une majorité parlementaire. Mais, là, elle se heurte à d’autres lobbys, aussi puissants qu’elle, sinon plus : le Club Massiac qui représente les intérêts d’une partie des planteurs de Saint-Domingue et des négociants des grandes villes portuaires. Ce club contrôle le Comité Colonial de l’Assemblée, par le biais de députés acquis au maintien du statu quo esclavagiste, comme Barnave ou les frères Lameth. Les arguments inlassablement ressassés sont que toute atteinte au système en place provoquerait la ruine économique de régions entières, et des troubles sociaux apocalyptiques aux colonies.
Les activités de la Société des Amis des Noirs sont également de traduire les ouvrages des abolitionnistes étrangers et de préparer des articles à insérer dans la presse nationale. Il y a également toute une dimension prospective : il s’agit se soutenir les initiatives visant à créer sur les côtes africaines des établissements reposant sur la liberté du travail et la liberté du commerce. Là aussi, le modèle reste l’Angleterre avec la Sierra leone.
À partir de l’automne 1789, la Société, sous l’impulsion de Grégoire, de Brissot et du métis dominguois Julien Raimond, tend à évoluer vers le club politique. Elle soutient résolument le groupe des libres de couleur, qui veut renverser les lois de ségrégation et obtenir l’égalité des droits politiques avec les colons blancs. Dès lors, les cibles privilégiées par les sociétaires sont moins les pouvoirs publics et les autorités établies, qu’elles soient coloniales ou commerciales, que les protagonistes d’un large mouvement révolutionnaire émergeant dans les colonies. Ce dernier est impulsé par les libres de couleur, mais en son sein les esclaves ne tardent pas à jouer leur propre partition pour un renversement de tout l’édifice esclavagiste. Cette radicalisation marginalise les sociétaires plus modérés, qui quittent la Société. Les effectifs, qui tournaient autour de 130 membres, s’amenuisent, les réunions se font plus irrégulières. La Société pâtit également de l’engagement politique dans les luttes métropolitaines de ses principaux animateurs.
Lors des années suivantes, les références à la Société restent présentes dans le débat public, jusqu’à l’abolition complète de l’esclavage dans toutes les colonies françaises par le bref décret du 16 pluviôse an II (4 février 1794). Pour ses adversaires, c’est un épouvantail que l’on brandit pour entretenir le mythe d’un comité occulte déterminé à ruiner les colonies pour le plus grand profit des ennemis de la France, l’Angleterre et l’Espagne. Pour ses partisans, c’est une signature vénérable que l’on invoque pour illustrer les liens très forts unissant la « révolution des couleurs » aux colonies, et le cours de la Révolution en métropole, sans toutefois trop évoquer les précurseurs tels que Brissot ou Clavière, guillotinés, entre autres motifs, pour avoir voulu « soulever les noirs ». Des réunions informelles et discrètes se tiennent parfois avec d’anciens sociétaires rescapés de la tourmente révolutionnaire, soit à Paris, soit au Cap à Saint-Domingue (actuelle Haïti).
Pendant le Directoire, régime français républicain libéral, s’opère la renaissance au grand jour. La Société des Amis des Noirs et des colonies souhaite reprendre le flambeau. Quelques tentatives de reprise des séances ont lieu entre 1795 et 1797, autour de membres du cercle dirigeant de la première société : l’abbé Grégoire ou le docteur François-Xavier Lanthenas, mais aussi le pasteur Benjamin-Sigismond Frossard ou le général Servan, ex-ministre de la Guerre. Mais c’est après septembre 1797 que la situation devient plus favorable. En éliminant les royalistes, le Directoire a aussi frappé les porte-parole du lobby qui souhaitaient rétablir progressivement ou brutalement l’esclavage. La Société des Amis des Noirs et des colonies se dote de statuts, tient des réunions beaucoup plus régulières. Elle s’élargit pour accueillir l’ingénieur d’origine suédoise Carl-Bernhard Wadström, réfugié en France, chantre de la « colonisation nouvelle » en Afrique, ou encore Jean-Baptiste Say, ancien secrétaire de Mirabeau, rédacteur du journal La décade philosophique, qui reflète les idées dominantes au sein de l’Exécutif. En accueillant des philanthropes notoirement connus comme Charles Leclerc de Montlinod, ou Charles-Philibert de Lasteyrie, elle renoue avec un courant qui s’affirmait dans les années précédant la Révolution. On note également la présence significative des députés noirs ou métis, comme Pierre Thomany, Etienne Mentor, Louis Boisrond ; et quelques femmes militantes, tout particulièrement Helen-maria Williams, ou les « citoyennes » Say et Wadström.
En formulant ses objectifs, et en définissant ses structures, la Société s’efforce de s’adapter à la situation nouvelle créée par le décret d’abolition du 4 février 1794, dont elle organise la commémoration annuelle. Il s’agit tout d’abord d’accompagner la « régénération » des sociétés où le décret est appliqué (Saint-Domingue, Guadeloupe, Guyane) ; œuvre d’éducation, tâches de restructuration des plantations qui fonctionnent avec une main-d’œuvre salariée, recherche d’innovations technologiques pour alléger le travail. Une première commission s’occupe de ces objectifs. Une deuxième commission s’occupe de la « colonisation nouvelle » (fondation de comptoirs sur la côte africaine, reposant sur le travail libre des Africains, offrant une perspective de substitution à l’esclavage), qui devient la grande affaire post-abolitionniste. Les deux autres commissions reprennent une partie des objectifs de la précédente société : écriture d’une histoire globale de la traite transatlantique ; traduction des ouvrages étrangers qui peuvent intéresser les abolitionnistes français.
Ces projets restent cependant inachevés. Au printemps 1799, une succession de vents contraires frappe de plein fouet la société. Deux de ses membres éminents décèdent : Wadström et Lanthenas. Les séances sont de plus en plus irrégulières. Sur un effectif de 92 sociétaires, on rassemble difficilement 5 membres présents par séance.
La Société souffre également de la conjoncture. Née dans l’ambiance de l’union républicaine, déterminée à préserver les acquis de la « révolution des couleurs », elle est devenue une institution officielle : ses réunions se tiennent désormais dans les locaux du Ministère de la Marine et des Colonies place de la Concorde. Elle a l’ambition de piloter la politique coloniale du Directoire. Mais, au printemps 1799, la belle unité républicaine vole en éclats. Une opposition républicaine démocratique se renforce, à laquelle sont associées des personnalités éminentes de la Société, comme Léger-Félicité Sonthonax, le père de l’abolition de l’esclavage à Saint-Domingue ou le jeune député noir Étienne Mentor. D’autres sont en retrait, sur des positions plus conservatrices : tel est le cas de Grégoire, de Say, ou de Pierre-Jean Cabanis. Contrairement à Truguet, le nouveau ministre de la Marine Bruix ne soutient pas la cause abolitionniste et fait fermer la salle où se tenaient les réunions de la Société. C’est un organisme moribond qui est ainsi achevé, laissant quelques notes et un dossier conséquent de projets sans lendemain.
Quelques mois plus tard, la réaction coloniale sous le Consulat rend la Société des Amis des Noirs responsable de tous les troubles coloniaux. C’est pourtant sur son legs que le mouvement abolitionniste se reconstruit après 1815.
À propos de l’auteur
Bernard Gainot est Maître de conférences HDR honoraire en histoire moderne, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, chercheur associé à l’Institut d’Histoire moderne et contemporaine (IHMC) ENS/Paris1. Ses domaines de recherche sont l’histoire des sociétés coloniales de la période moderne ; l’histoire impériale, plus particulièrement les conflits dans les espaces coloniaux entre 1763 et 1830 ; l’histoire politique de l’Europe méditerranéenne (France, Italie, Espagne) entre 1792 et 1830.
Bibliographie
Marcel Dorigny et Bernard Gainot, La Société des Amis des Noirs : 1788-1799. Contribution à l’histoire de l’abolition de l’esclavage, Paris, UNESCO, coll. « Mémoire des peuple », 1998, 396 p.
Marcel Dorigny et Bernard Gainot (dir.), La colonisation nouvelle (fin XVIIIe-début XIXe siècles), Paris, Éditions SPM, 2018, 210 p.
Olivier Grenouilleau, La révolution abolitionniste. Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 2017, 512 p.
All rights reserved | Privacy policy | Contact: comms[at]projectmanifest.eu
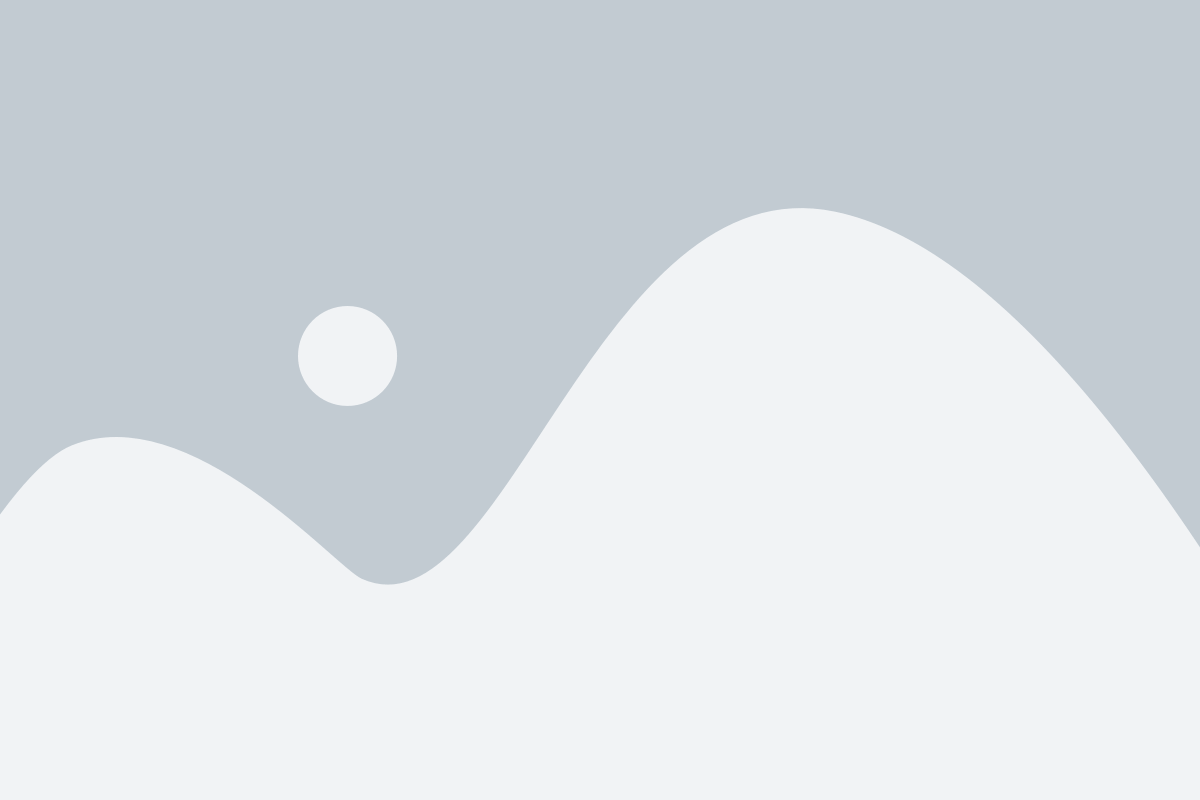
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.