
December 13, 2022
Bernard MICHON
À l’époque moderne, la colonisation européenne est marquée par la mise en place d’une économie de plantation en Amérique et dans l’océan Indien, recourant à la main-d’œuvre servile déportée massivement depuis le continent africain. La France, en tant que puissance maritime et coloniale, a pris une part active à ce commerce d’êtres humains, impulsé depuis un petit nombre de ports métropolitains. La traite des esclaves africains est alors légalisée, règlementée et encouragée par l’État.
La première forme de mondialisation européenne, née au 17e siècle dans le sillage des voyages d’explorations et des conquêtes territoriales qui suivirent, a conduit au développement dans les colonies d’une économie ou d’un système de plantation. Nommées plantation, habitation, estate ou ingenio selon les lieux, ces structures agricoles peuvent se définir par trois critères principaux : d’abord une production très largement assurée par le travail forcé, souvent esclavagiste ; ensuite une organisation de type capitaliste caractérisée par d’importants investissements financiers et la recherche de gains élevés ; enfin un fonctionnement économique très dépendant du commerce maritime pour l’exportation de leurs productions et de l’importation de vivres et en produits manufacturés. Si la production du sucre de canne en constitue le modèle « archétypal », d’autres plantes exotiques sont également concernées : tabac, indigo, coton, cacao et café.
En l’absence d’évolution technique majeure, il faut toujours plus de bras pour produire davantage de produits coloniaux, afin de satisfaire les besoins croissants des Européens consommateurs de sucre, de café, de tabac et d’étoffes légères et colorées (indiennes). Le recours à la main-d’œuvre servile, massivement déportée depuis le continent africain, s’impose comme la solution privilégiée par les Européens, en raison de la mortalité considérable des populations amérindiennes et de la faiblesse de l’émigration des engagés venus du vieux continent. Les spécialistes s’accordent pour estimer l’ampleur de la déportation opérée par les traites occidentales, du xvie siècle aux années 1860, entre 12 et 13 millions d’hommes, de femmes et d’enfants, dont environ 15 % trouvent la mort au cours du voyage à destination des colonies européennes.
Au total, la France a organisé plus de 4 400 expéditions de traite qui ont conduit entre le 17e siècle et le milieu du 19e siècle à la déportation de 1,3 à 1,4 million d’Africains principalement à travers l’océan Atlantique vers ses colonies américaines des Grandes Antilles (Saint-Domingue, actuelle Haïti), des Petites Antilles (Saint-Christophe, actuelle Saint Kitts ; Martinique, Guadeloupe, Sainte-Lucie), de la Guyane, de la Louisiane et, dans une moindre mesure, à destination de l’océan Indien (îles Bourbon et de France, actuelles îles de la Réunion et Maurice).
Le commerce avec les colonies de plantation et la traite ont contribué au développement des grands ports français et, plus largement, à la croissance économique de la France. La hiérarchie des ports de traite français est dominée de très haut par Nantes (environ 1 800 expéditions et plus de 550 000 Africains acheminés), devant Le Havre (520 expéditions), Bordeaux et La Rochelle (480 expéditions chacun). En tout, une vingtaine de ports métropolitains a équipé des navires pour pratiquer la traite, dont sept dépassent la centaine d’armements. Parmi les différents trafics maritimes, la traite apparaît en effet comme particulièrement risquée et aléatoire, nécessitant une importante mobilisation de capitaux. Il s’agit bien d’un « commerce riche » (O. Grenouilleau) permettant parfois de dégager des profits très importants.
À l’échelle des colonies françaises de l’Amérique, l’introduction d’esclaves africains débute dès 1626, grâce à une permission accordée par Richelieu, quelques mois seulement après la prise de possession de l’île de Saint-Christophe (Petites Antilles). En 1642, Louis XIII autorise ses sujets à pratiquer la traite, à condition que les captifs soient convertis au christianisme. Sous le règne de Louis XIV qui souhaite renforcer le pouvoir royal dans les colonies, un arsenal législatif, connu sous le nom de « Code noir », appellation datant en réalité du début du 18e siècle, se charge d’organiser les rapports entre maîtres et esclaves dans plusieurs domaines (statut servile, logement, châtiment). Cet ensemble de textes reste en vigueur, avec des adaptations et des évolutions, jusqu’à l’abolition de l’esclavage, intervenue une première fois au cours de la période révolutionnaire en 1794 puis, après son rétablissement en 1802, jusqu’en 1848. Les esclaves y apparaissent comme des êtres humains christianisés, privés de personnalité juridique et légalement appropriés par autrui. En pratique, cette législation reste largement inappliquée, en raison principalement de la résistance des maîtres qui considèrent que l’État n’a pas à s’immiscer dans le système esclavagiste.
À propos de l’auteur
Bernard Michon est maître de conférences en histoire moderne à Nantes Université et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique (CRHIA-UR 1163). Ses travaux portent sur l’histoire des ports de commerce français et européens aux 17e et 18e siècles. Il s’intéresse également à l’histoire de la traite atlantique. Ses recherches récentes le conduisent à étudier l’histoire du café, de sa production à sa consommation.
Bibliographie
Boulle Pierre H., Race et esclavage dans la France d’Ancien Régime, Paris, Perrin, 2006.
Charon, Philippe (dir.), Commerce atlantique, traite et esclavage (1700-1848). Recueil de documents des Archives départementales de Loire-Atlantique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018.
Le Mao, Caroline (dir.), Bordeaux, La Rochelle, Rochefort, Bayonne. Mémoire noire. Histoire de l’esclavage, Bordeaux, Mollat, 2020.
Niort, Jean-François, Le Code Noir. Idées reçues sur un texte symbolique, Paris, Le Cavalier Bleu, 2015.
Petre-Grenouilleau, Olivier, Les traites négrières : essai d’histoire globale, Paris, Gallimard, Bibliothèque des histoires, 2004.
Regent, Frédéric, La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, 1620-1848, Paris, Grasset, 2007.
« Avant de parler du règlement proposé, il ne sera pas inutile de faire les observations qui suivent sur le commerce de ces nègres esclaves, qui se pratique avec le soutien et l’accroissement de nos colonies en Amérique. […] Les motifs de ces édits [l’auteur évoque les textes de lois encadrant le commerce des esclaves] sont fondés sur ce que la traite des nègres qu’on porte aux Isles de l’Amérique est absolument nécessaire pour les cultures des sucres, cotons, indigos et autres denrées qui sont apportées de ces pays en France.
Ce commerce qui par la vénalité des hommes les rend comparables aux bestiaux, ne serait pas autorisé sans le besoin indispensable qu’on a de leur service dans nos colonies ; et sans que les nègres que nous y transportons sortent de l’erreur et de l’idolâtrie pour y recevoir le baptême, et qu’ils y sont instruits avec soin dans la religion romaine par les prêtres et les missionnaires proposés à cet effet.
D’ailleurs la [N]igritie* est une grande région d’Afrique divisée en plusieurs royaumes, dont les peuples sont si nombreux qu’il leur serait difficile de subsister, si par le trafic d’esclaves ils n’étaient déchargés tous les ans d’une partie de ceux qui l’habitent. Ces peuples étant accoutumés à se faire la guerre les uns aux autres, ils se porteraient à faire mourir les captifs qu’ils font pendant la guerre, sans qu’ils se trouvent obligés de les conserver pour les vendre ou les échanger contre les denrées et les marchandises qui leurs sont envoyées soit par nos vaisseaux soit par ceux des [A]nglois, [H]ollandais et [P]ortugais.
[…] Au fond les nègres sont naturellement enclins au vol, au larcin, à la luxure, à la paresse et à la trahison, et si l’on peut ajouter foi aux annales galantes et aux anecdotes d’Espagne, on s’en sert à des usages qu’il convient d’éloigner. En général ils ne sont propres qu’à vivre dans la servitude, et pour les travaux et la culture des terres du continent de nos colonies d’Amérique. »
Orthographe et tournures modernisées.
Arch. dép. Loire-Atlantique, C 742, Chambre de commerce de Nantes, traite des Noirs, n° 38, cote 8, « Réponses au mémoire présenté à Nosseigneurs du Conseil Royal de la Marine concernant les nègres esclaves que les officiers et habitants des colonies françoises de l’Amérique amènent en France pour leur service ».
* : Nom donné par les Français au début du 18e siècle à un territoire s’étendant de l’actuel territoire des États du Mali, du Niger et du Tchad.
Au moment de la rédaction du document, Gérard Mellier (1674-1729) occupe la fonction de subdélégué de l’intendant de Bretagne à Nantes dont il devient par la suite maire à partir de 1720. Plusieurs chercheurs, notamment Pierre H. Boulle et Philippe Le Pichon, ont déjà souligné l’intérêt de ce texte, en ce qu’il préfigure le texte de loi adopté en octobre 1716, réglementant le séjour des esclaves noirs en métropole. Mellier est un fin connaisseur du milieu négociant, auquel il est lié, et soutient sans ambiguïté le développement du commerce des esclaves.
L’auteur mobilise trois arguments principaux qui furent constamment repris par les « amis des colonies », c’est-à-dire les partisans de l’esclavage, jusqu’à sa seconde abolition dans les colonies françaises en 1848.
Le premier est d’ordre économique et consiste à souligner la nécessité du recours à la main-d’œuvre servile pour la mise en valeur des colonies (« le soutien et l’accroissement de nos colonies en Amérique », « absolument nécessaire pour les cultures », « sans le besoin indispensable qu’on a de leur service dans nos colonies », « pour les travaux et la culture des terres du continent de nos colonies ») : renoncer à l’esclavage reviendrait à ruiner tout un secteur de l’économie française, en pleine croissance au début du 18e siècle, dans le cadre d’une vive concurrence entre les puissances européennes (l’auteur évoque les « [A]nglois, [H]ollandais et [P]ortugais » qui sont également présents le long des côtes africaines).
Le deuxième revient à considérer que le sort des esclaves dans les colonies européennes est plus enviable que s’ils étaient restés sur le continent africain (« si nombreux qu’il leur serait difficile de subsister », « ils se porteraient à faire mourir les captifs »). Dans le prolongement de cet argument, il est possible de mentionner l’aspect religieux (« sortent de l’erreur et de l’idolâtrie pour y recevoir le baptême ») : les esclaves sont convertis au catholicisme romain – cette condition a été posée par Louis XIII pour légaliser le commerce des esclaves en 1642 – leur âme est donc sauvée.
Le troisième conduit à justifier l’esclavage des Africains par leur infériorité supposée (« ils ne sont propres qu’à vivre dans la servitude ») : ce sont des sauvages, pratiquement des animaux, dont il faut se méfier. Le vocabulaire animalier, utilisé par l’auteur (« les rend comparables aux bestiaux »), se retrouve également dans les termes fréquemment employés pour qualifier les captifs au cours de la traite : on parle de « testes de nègres » comme on parlerait de « testes de bétails », on évoque les esclaves « de rebus », ou « défectueux », ou au contraire les « Noirs pièces d’Indes » pour désigner les plus beaux spécimens, ce qui illustre la marchandisation dont sont victimes les captifs.
La sexualité débridée, évoquée par Mellier de façon allusive, participe aussi à cette vision dépréciative des Africains et à leur animalisation. Un processus de racialisation est à l’œuvre, appuyé sur un discours pseudo-scientifique, développé dans des œuvres comme l’Histoire naturelle de Buffon, publiée à partir de 1749, et imprègne certains auteurs de la pensée des Lumières. Le résultat est de faire de l’Africain noir un esclave par essence, par nature : ainsi le mot « nègre », emprunté à l’espagnol « negro », désigne au 15e siècle une personne de race noire, avant de prendre au 18e siècle le sens d’esclave noir.
All rights reserved | Privacy policy | Contact: comms[at]projectmanifest.eu
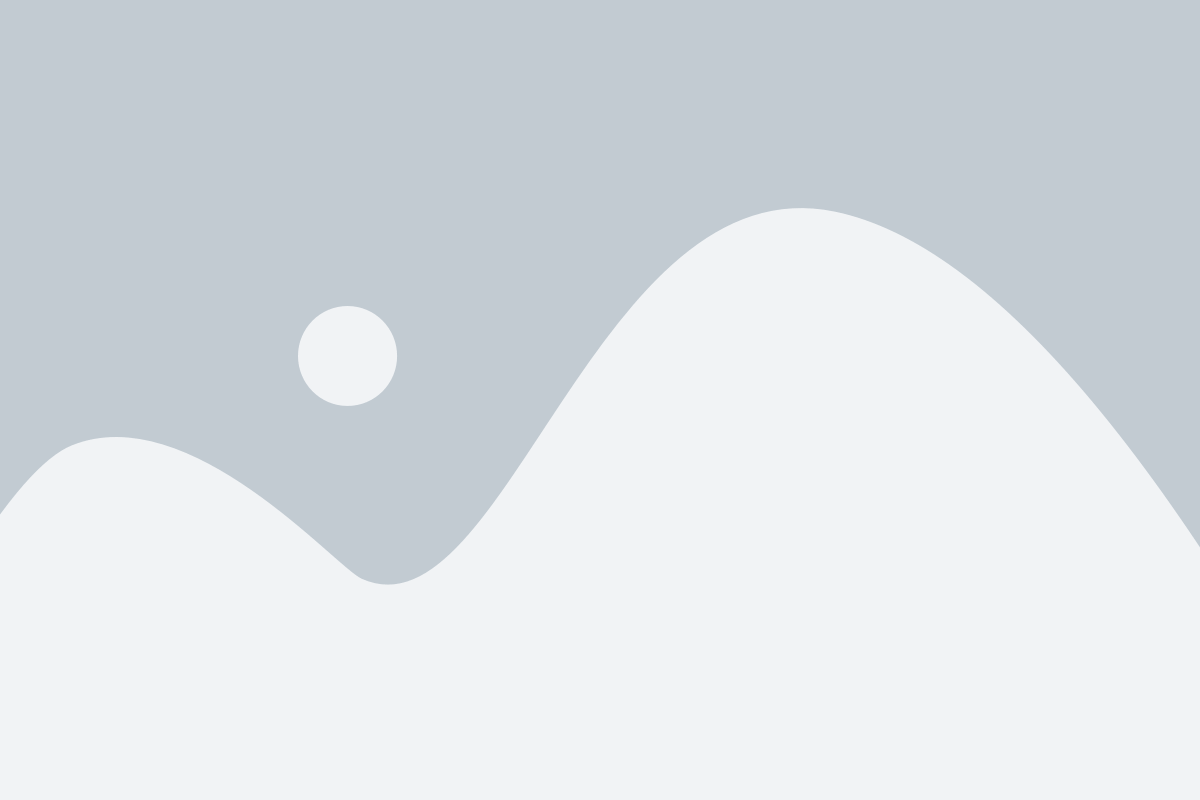
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.